Merveilles du génie de l'homme : découvertes, inventions, récits, historiques, amusants et instructifs sur l'origine et l'état actuel des découvertes et inventions les plus célèbres / Par Amédée de Bast.
381/490
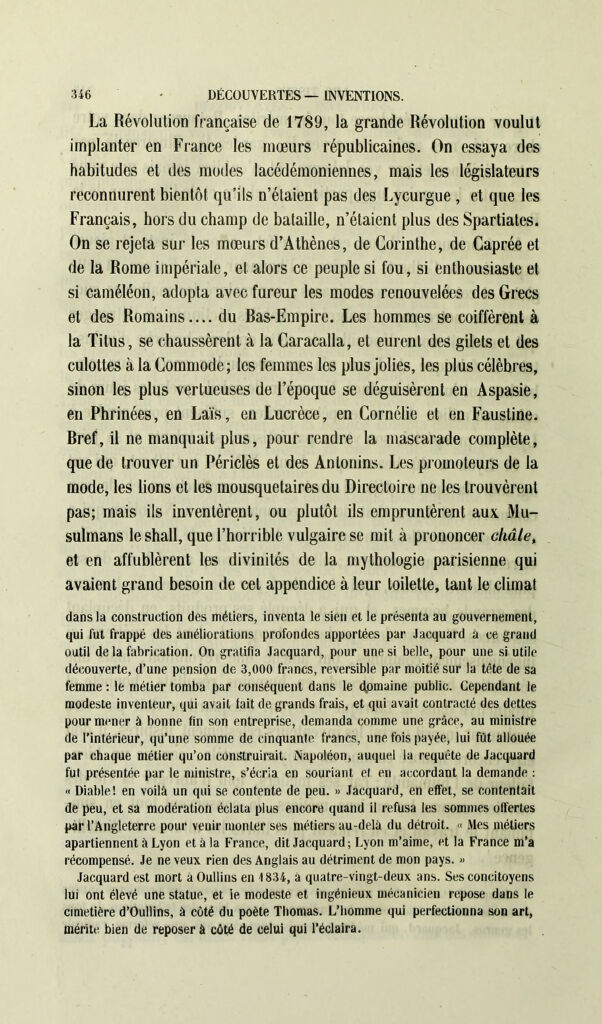
346 (canvas 382)
The image contains the following text:
La Révolution française de 1789, la grande Révolution voulut
implanter en France les mœurs républicaines. On essaya des
habitudes et des modes lacédémoniennes, mais les législateurs
reconnurent bientôt qu’ils n’étaient pas des Lycurgue, et que les
Français, hors du champ de bataille, n’étaient plus des Spartiates.
On se rejeta sur les mœurs d’Athènes, de Corinthe, de Caprée et
de la Rome impériale, et alors ce peuple si fou, si enthousiaste et
si caméléon, adopta avec fureur les modes renouvelées des Grecs
et des Romains.... du Bas-Empire. Les hommes se coiffèrent à
la Titus, se chaussèrent à la Caracalla, et eurent des gilets et des
culottes à la Commode; les femmes les plus Jolies, les plus célèbres,
sinon les plus vertueuses de l’époque se déguisèrent en Aspasie,
en Phrinées, en Laïs, en Lucrèce, en Cornélie et en Faustine.
Bref, il ne manquait plus, pour rendre la mascarade complète,
que de trouver un Périclès et des Antonins. Les promoteurs de la
mode, les lions et les mousquetaires du Directoire ne les trouvèrent
pas; mais ils inventèrent, ou plutôt ils empruntèrent aux. Mu-
sulmans le shall, que l’horrible vulgaire se mit à prononcer châle^
et en affublèrent les divinités de la mythologie parisienne qui
avaient grand besoin de cet appendice à leur toilette, tant le climat
dans la construction des métiers, inventa le sien et le présenta au gouvernement,
qui lut frappé des améliorations profondes apportées par .lacquard à ce grand
outil de la fabrication. On gratifia Jacquard, pour une si belle, pour une si utile
découverte, d’une pension de 3,000 francs, réversible par moitié sur la tête de sa
femme : le métier tomba par conséquent dans le dpmaine public. Cependant le
modeste inventeur, qui avait fait de grands frais, et qui avait contracté des dettes
pour mener à bonne fin son entreprise, demanda comme une grâce, au ministre
de l’intérieur, qu’une somme de cinquante francs, une fois payée, lui fût allouée
par chaque métier qu’on construirait. Napoléon, auquel la requête de Jacquard
fut présentée par le ministre, s’écria en souriant et en accordant la demande ;
« Diable! en voilà un qui se contente de peu. » Jacquard, en effet, se contentait
de peu, et sa modération éclata plus encore quand il refusa les sommes offertes
par l’Angleterre pour venir monter ses métiers au-delà du détroit. « Mes métiers
apartiennent à Lyon et à la France, dit Jacquard; Lyon m’aime, et la France m’a
récompensé. Je ne veux rien des Anglais au détriment de mon pays. »
Jacquard est mort à Oullins en 1834, à quatre-vingt-deux ans. Ses concitoyens
lui ont élevé une statue, et le modeste et ingénieux mécanicien repose dans le
cimetière d’Oullins, à côté du poète Thomas. L’homme qui perfectionna son art,
mérite bien de reposer à côté de celui qui l’éclaira.